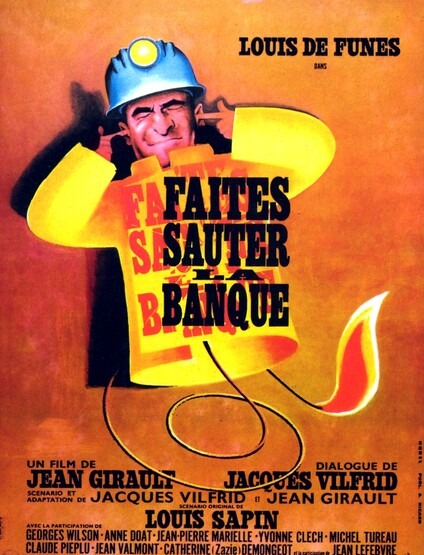Les règles de bienséance imposent aux couples de ne pas se « larguer » par téléphone. Il en est de même en droit du travail, comme une jurisprudence de la Cour de cassation l’a récemment confirmé (Cass. soc. 28-9-2022 n° 21-15.606 F-D, Sté Bourg Distribution c/ S).
En l’espèce, un employeur, certainement pétri de bonnes intentions et ne voulant pas faire durer le suspense, avait, simultanément à l’envoi de la lettre de rupture, téléphoné à son futur ex salarié pour l’informer de ce qu’il était licencié. Bien mal lui en a pris, car ce faisant, il prenait le risque d’une requalification en licenciement verbal, et donc abusif. Le juge saisi du litige – car ces choses-là arrivent ! – doit alors mener un travail d’enquête, pour établir la chronologie des faits.
La cour d’appel a ainsi conclu que le salarié démontrait avoir été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l’envoi du courrier de licenciement. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la portée d’un licenciement verbal, elle a jugé cette rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à indemniser le salarié de son préjudice (Cass. soc. 12-12-2018 no 16-27.537 F-D : RJS 3/19 no 157).
L’employeur a formé un pourvoi en cassation, en rappelant que c’est le jour d’envoi de la lettre qui marque la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail et donc entérine la rupture, et d’avoir téléphoné le même jour serait donc sans incidence.
Mais attention, car c’est là que cela devient subtil : est-ce la date ou l’heure de l’expédition du courrier qui devait être retenue ?
La Cour de cassation, saisie du litige, entend l’argument de l’employeur et censure la décision des juges du fond. La cour d’appel n’aurait pas dû se contenter de comparer les jours, elle aurait dû vérifier les heures, car il ne pouvait être exclu que l’appel téléphonique se soit produit après l’envoi de la lettre (le cachet de la Poste faisant foi n’est-ce pas). Ce travail devra donc être fait par la Cour d’appel de renvoi, qui effectuera donc un véritable travail d’enquête avec relevés téléphoniques et heures d’ouverture du bureau de poste (on recommande en tout état de cause de toujours bien conserver le récépissé de la Poste, car il est bien utile pour faire foi).
Sébastien Bourdon