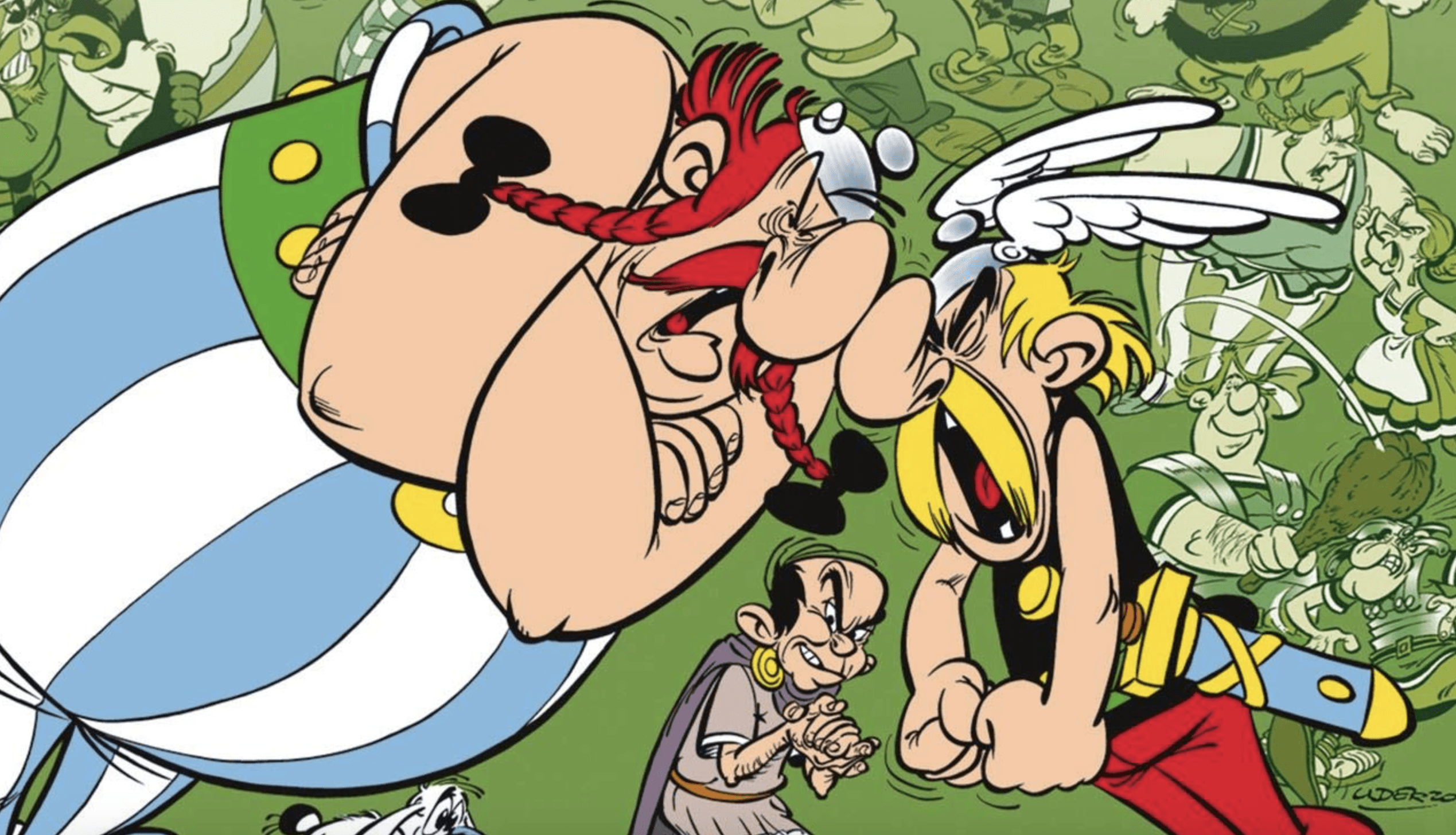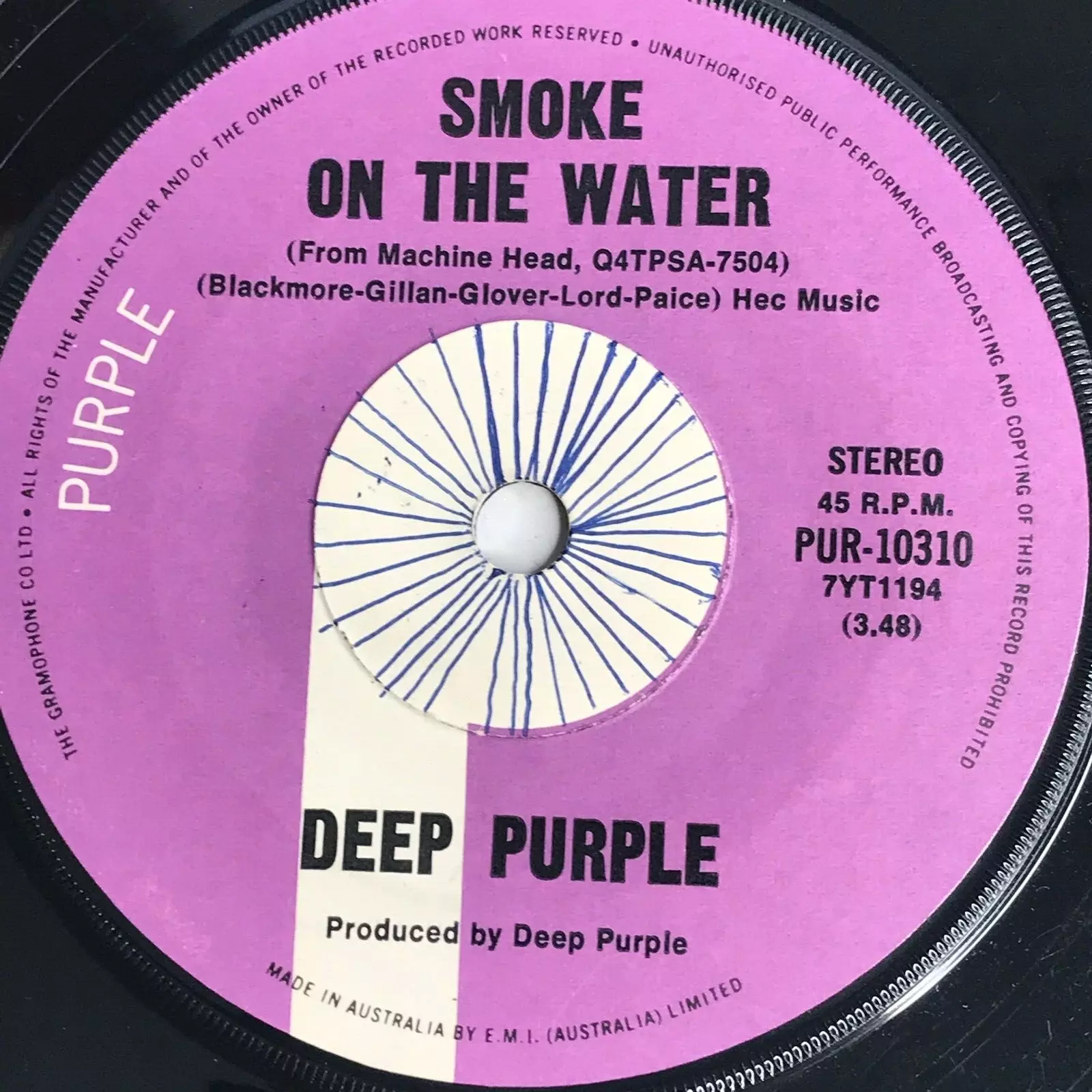La justice est humaine, ce qui oblige la Cour de cassation à traiter de tous les sujets, même scabreux, pour en tirer de grands principes, élevant ainsi un peu le débat.
Il était une fois une entreprise au sein de laquelle le président entretenait une liaison avec une salariée. Jusque-là rien que de très banal, mais l’affaire se pimentait d’un détail qui n’en était pas un : l’épouse du mari volage était également directrice générale de la société.
La maîtresse, quant à elle, exerçait les nobles fonctions de Directrice des Ressources Humaines. Licenciée pour faute grave du fait de divers manquements allégués, elle conteste judiciairement la mesure, affirmant que son licenciement porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée.
En effet, la décision de rupture serait, selon elle, liée à la découverte de sa liaison avec le président par l’épouse de ce dernier, la veille de sa convocation à l’entretien préalable (coïncidence ?). Or, le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale dont la violation entraîne la nullité du licenciement.
En cause d’appel, les juges du fond ont écarté les manquements reprochés, ont considéré que l’atteinte à la vie privée était établie, mais ont estimé que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, et non nul. La salariée vengeresse s’est donc pourvue en cassation.
La Cour de cassation en a profité pour rappeler qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Par ailleurs, et en application de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme, de l’article 9 du Code civil et de l’article L 1121-1 du Code du travail, la Haute Juridiction a rappelé que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Tout licenciement sur ce fondement est donc nul (article L 1235-3-1 du Code du travail).
Ce n’est pourtant pas la liaison qui avait expressément motivé la rupture, mais des fautes professionnelles. Il a bien fallu raccrocher les wagons, et la Cour de cassation a rappelé, en premier lieu, qu’aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’était établi.
Ensuite, elle a relevé que la véritable cause du licenciement est bien la découverte par l’épouse du président de la liaison que la salariée entretenait son mari. Il est vrai qu’elle avait exigé de son mari qu’il la licencie sur le champ…
Ainsi, il convenait de chercher la réalité de la motivation et non les faits énoncés dans la lettre, en l’espèce de pure façade. La cour d’appel aurait dû déduire de ses constats que le licenciement était fondé sur un fait relevant de l’intimité de la vie privée de la salariée, et qu’il était ainsi frappé de nullité.
La Haute Juridiction prononce donc la nullité du licenciement, sans renvoi (Cass. soc. 4-6-2025 no 24-14.509 F-D, P. c/ Sté Sodico expansion).
La vie sentimentale est chose complexe, au travail comme ailleurs, et peut-être eût-il été paradoxalement judicieux de rompre le contrat en invoquant frontalement la liaison et les risques de trouble dans la communauté de travail qu’elle pouvait potentiellement engendrer…
Sébastien Bourdon