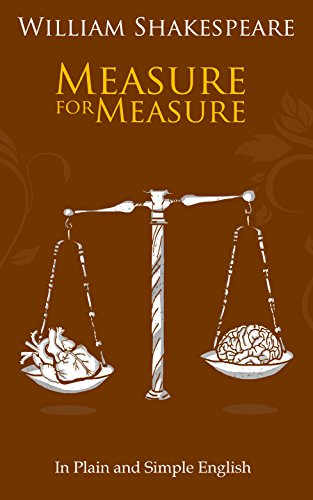Depuis le début du confinement, les Conseils de prud’hommes de France et de Navarre sont fermés, et les seules réponses que l’on peut obtenir de cette excellente institution relèvent les plus souvent d’e-mails lapidaires et sibyllins de cet ordre : « En raison de la situation sanitaire nationale, tous les services du Conseil de Prud’hommes de … sont fermés. En conséquence, le dépôt de requêtes, toutes les audiences, le rendu et la notification des décisions sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. D’autre part, nous vous informons que les messages électroniques reçus sur cette boîte aux lettres ne pourront pas être traités ».
Cela a le mérite d’être clair, mais on ne m’ôtera pas de l’esprit que la seule situation sanitaire suffise à expliquer un effacement aussi radical d’une institution essentielle au fonctionnement de la société.
Si la moitié des salariés français se trouve être au chômage partiel depuis le 22 avril, l’autre ne l’est pas, et dans un cas comme dans l’autre, nombre de problématiques vont surgir et on conçoit mal comment une institution déjà engluée dans des délais à rallonge va pouvoir digérer l’afflux de dossiers (et ce d’autant qu’à l’ouverture, les mesures de sécurité sanitaires se traduiront sans doute par des audiences réduites, afin d’éviter les pics d’affluence habituels).
Si la question de l’impréparation de l’Etat est particulièrement prégnante ces jours-ci et dans de nombreux domaines, force est de constater qu’elle est ici totale et que l’on n’avait tout simplement rien prévu. Et ce n’est pas le silence assourdissant des autorités de l’Etat sur le sort de la Justice à chacune de leurs interventions qui nous rassurera.
Se profile donc à l’horizon un encombrement abyssal des juridictions du travail dans un monde où un tiers des avocats aura disparu (chiffres CNB : entre ceux qui projettent de changer de profession (28 %), les retraites anticipées (6 %) et les fermetures définitives de cabinets (6 %), ils seraient environ 28 000 à quitter la profession dans les prochains mois).
Il n’y a guère de chiffres qui ne donnent le tournis ces temps derniers, mais la situation interroge à tout le moins, et puisque nous n’avions rien prévu, ne serait-il pas temps de préparer un peu l’avenir (d’autant qu’il est particulièrement sombre à défaut d’être incertain – ou l’inverse).
Au début du confinement, alors que je devais me rendre au Conseil de prud’hommes de Paris pour entériner en Bureau de Conciliation et d’Orientation un protocole d’accord, cette audience, comme toutes les autres, a été reportée sine die, sans message, sans rien, par simple effet de porte close.
Mon excellent client (comme tous mes clients) me fit alors part de son étonnement, bien légitime. Ce dernier s’est légitimement interrogé auprès de moi : comment n’existait-il pas déjà un système type « échange documentaire, éventuellement certifié ? (…) A période exceptionnelle, mesure exceptionnelle qui de plus, soulagerait l’administration judiciaire qui n’avait pas besoin de cet épisode nouveau. »
Cette question, pertinente début mars, risque de l’être encore pour un moment.
Ayant quelques relations avec le Québec, je me suis interrogé sur ce que propose le laboratoire de cyberjustice (unité de recherche du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal) et sur la manière dont ses concepts et travaux de dématérialisation du procès pourraient trouver écho en ces temps troublés.
Dirigé par le professeur de droit Karim Benyekhlef, ledit laboratoire développe des plateformes Web qui permettent une « dématérialisation » des processus judiciaires et une simplification des interactions entre les acteurs concernés. Ne serait-ce pas exactement ce dont nous aurions aujourd’hui besoin ?
En effet, ces plateformes rendent possible l’administration de la justice entièrement à distance grâce aux audiences en ligne ou encore à la négociation et à la médiation à distance des conflits
S’agissant, comme en l’espèce, de formaliser un accord conclu de longue date entre les parties, tout semble absurde dans le fait qu’aucun système de cet ordre n’ait été mis en place en France. En effet : renvoi sans date donnant une incertitude à un litige qui n’en avait plus, coût carbone du déplacement des parties, risque sanitaire lié à la propagation du virus etc.
Laissons d’ailleurs le mot de conclusion au professeur Benyekhlef : « Si, en temps ordinaire, la cyberjustice contribue à rendre la justice plus accessible et plus concrète pour tous nos concitoyens, elle devient, en ces temps de crise (sanitaire et d’isolement social), la première condition de la résilience de la justice dans nos sociétés et, par conséquent, la seule garantie de la protection sociale et économique des citoyens par les tribunaux. Une protection qui semble essentielle pour concevoir une sortie de crise ».
Sébastien Bourdon