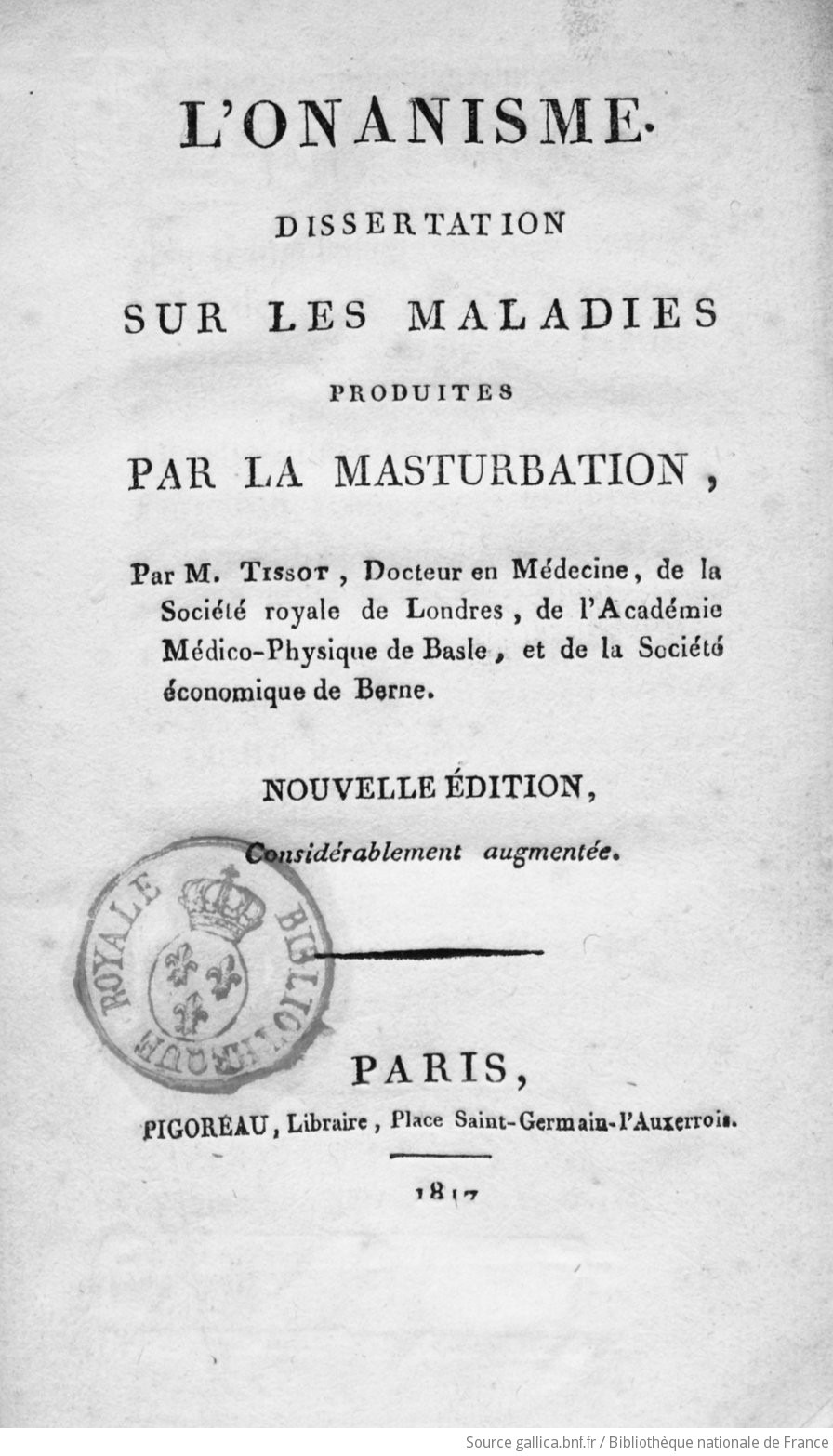L’été est passé, le temps s’est écoulé sans qu’on y prenne garde, c’est le moment idéal pour évoquer des questions de prescription.
S’agissant des poursuites disciplinaires, l’employeur a deux mois pour engager une procédure à partir du jour où il a une connaissance exacte et complète des faits fautifs qu’il reproche au salarié.
Le chronomètre du délai de prescription des poursuites disciplinaires se met en route le jour où l’employeur (au sens large) a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié (Cass. soc. 17-2-1993 no 88-45.539 P ; CE 20-4-2005 no 254909).
Quelle serait alors l’incidence d’une enquête interne sur ce délai de prescription, c’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu (Cass. soc. 29-5-2024 n° 22-18.887 F-D, Sté Schneider Electric France c/ I.).
En effet, dans certains cas, les faits fautifs ou leur ampleur exacte sont révélés par une enquête interne ou un audit, et la date de leur connaissance par l’employeur, point de départ du délai d’engagement des poursuites disciplinaires, a pu être fixée à la date de remise du rapport d’enquête.
Mais si les juges constatent que l’employeur a eu plus tôt une pleine connaissance des faits qu’il reproche au salarié, c’est cette date qui fait courir le délai, comme l’a rappelé la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une enquête interne avait été déclenchée le 13 octobre 2017, avec remise du rapport le 29 novembre suivant. Dans l’intervalle, le 30 octobre, le salarié était passé à table et avait envoyé à son supérieur hiérarchique un e-mail décrivant de manière circonstanciée le montage frauduleux qu’il avait mis en place.
Les juges du fond comme de la Cour ont considéré que la lecture des aveux circonstanciés du salarié avait suffi à une connaissance exacte des fautes, sans avoir besoin de l’enquête. C’est donc à partir du 30 octobre que courait le délai deux mois pour engager une procédure disciplinaire. La convocation à entretien préalable fait le 3 janvier 2018 était arrivée trop tard dans un monde trop vieux, privant de cause réelle et sérieuse le licenciement qui s’en est suivi.
Cet arrêt a le mérite d’être clair dans sa motivation, reste qu’il n’est pas forcément toujours aisé de savoir à partir de quand on peut considérer être suffisamment et pleinement informé, au point de pouvoir prendre une décision de rupture qui tienne la route judiciaire.
Sébastien Bourdon