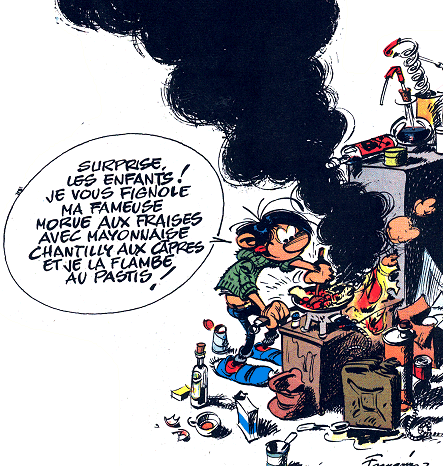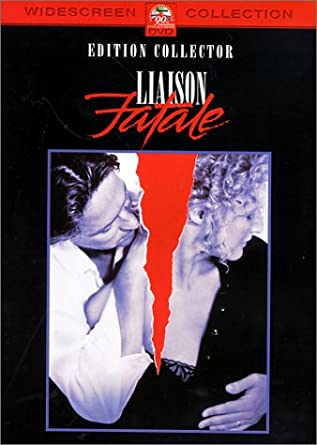Le retour du fils de la revanche : alors qu’un calme apparent régnait, voilà que la Cour d’appel de Paris en remet une couche et écarte dans une décision récente l’applicabilité du barème prud’homal dit « Macron » (CA Paris 16-03-2021 n° 19/08721, X. c/ Mutuelle Pleyel Centre de santé mutualiste).
Comme dans les espèces précédentes, aux solutions panachées selon les Cours saisies, était sur la sellette la conformité de ce barème aux textes internationaux, et plus particulièrement à la convention 158 de l’OIT qui exige une indemnisation appropriée du salarié dont le licenciement est injustifié.
Ce n’est pas la première Cour à passer outre – et probablement pas la dernière : suivant une logique qui sous-tend tous les argumentaires des opposants à cette tarification du préjudice, la Cour d’appel de Paris écarte à son tour l’application du barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il ne permet pas d’assurer une réparation adéquate du préjudice subi par le salarié.
Belle et rebelle, la Cour d’appel parisienne se moque donc comme d’une guigne des deux avis rendus en juillet 2019 en formation plénière de la Cour de cassation qui, après le Conseil d’État, avait conclu à la compatibilité du barème prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Le gaulois est réfractaire dit-on, et cela n’avait déjà pas empêché certaines cours d’appel d’écarter son application au cas par cas en fonction des circonstances de l’espèce en exerçant leur contrôle « in concreto », lorsque son application ne permet pas d’assurer une réparation adéquate aux salariés injustement licenciés (CA Reims 25-9-2019 no 19/00003 ; CA Grenoble 2-6-2020 no 17/04929).
La Cour d’appel de Paris, qui s’était d’abord sagement alignée sur les avis de la Cour de cassation, tourne casaque et accorde à une salariée dont le licenciement économique a été déclaré sans cause réelle et sérieuse une indemnité à ce titre d’un montant supérieur au plafond prévu par le barème.
Evidemment, ce qui intéresse ici, au-delà de cette position dissidente de Cour, c’est ce qu’a bien pu subir la salariée concernée du fait de cette perte d’emploi, justifiant une réparation supérieure au quantum fixé légalement.
La réponse apportée est sans surprise et pourrait même constituer l’exemple type, l’illustration archétypale de l’imperfection originelle du texte établissant le barème.
La salariée licenciée comptant moins de 4 ans d’ancienneté, pouvait prétendre, aux termes de l’article L 1235-3 précité, à une indemnité d’un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire brut, soit en l’espèce à un maximum de 17 615 €.
Et c’est exactement là que les juges ont fait leur boulot en appréciant in concreto le sort de la salariée : elle était âgée de 53 ans à la date de la rupture, soit un âge où il est difficile de se recaser (je parle d’employabilité) et plus encore au regard de sa formation et de son expérience professionnelle (maigre donc).
Partant de cette appréciation formée au regard des pièces versées, la Cour s’assied sur le barème et alloue 32 000 Euros à la salariée, soit un peu plus de 7 mois de salaire.
Il est plus que probable que cette décision ne soit pas isolée dans les temps qui viennent, et que l’employeur ne puisse faire l’économie (si j’ose dire) de se mettre à la place du juge en appréciant un risque finalement réel et pas seulement évalué en fonction d’un barème potentiellement toujours contestable. Et ce sera justice ? A chacun d’analyser cette possible évolution jurisprudentielle selon ses convictions…
Sébastien Bourdon