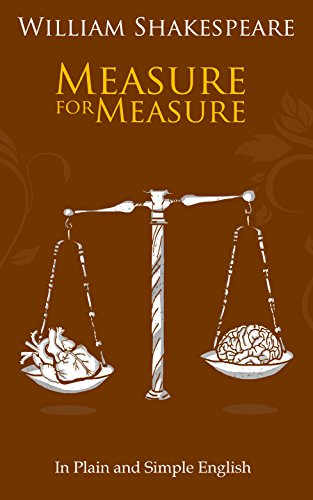Il arrive que bon an mal an de légitimes et nécessaires évolutions sociétales fassent leur chemin, pour être finalement entérinées devant les tribunaux.
Ce dont il est ici question semble ainsi relever de l’évidence et pourtant la Cour de cassation a jugé utile de le rappeler : adopter un comportement sexiste et dégradant sur le lieu de travail, ou à l’occasion du travail, constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-21.877 F-D, Sté Octapharma c/ F).
En principe, dans le cadre de son contrôle de la faute grave, la Cour de cassation se limite à éventuellement censurer les erreurs manifestes des juges du fond dans leur qualification des faits fautifs. Si l’on résume, ce qui relève de la faute, ou ce qui s’en détache.
C’est ainsi que, sans grande surprise, la Cour de cassation a considéré par exemple que le racisme ou l’antisémitisme ne pouvaient être qualifiés de faute simple, mais nécessairement de faute grave, donc incompatible avec le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 5-12-2018 no 17-14.594 F-D pour des propos racistes ; Cass. soc. 2-6-2004 no 03-45.269 FS-PBRI pour des insultes antisémites ; Cass. soc. 19-1-2010 no 08-42.260 F-D en cas d’atteinte à la dignité d’un autre salarié).,
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mai dernier fournit une nouvelle illustration de la manière dont ce contrôle est exercé.
Venons-en d’abord aux faits, c’est plus imagé : un agent de fabrication employé par un laboratoire pharmaceutique était notamment accusé d’avoir tenu des propos dégradants et humiliants à connotation sexuelle et ouvertement sexiste à l’encontre de l’une de ses collègues et en présence d’autres salariés. Il se serait notamment publiquement adressé à elle en ces termes (choisis) : « tu sais que j’ai envie de te casser le cul ».
La lettre de licenciement n’évoquait pas le harcèlement sexuel à proprement parler (et même à parler salement), mais l’employeur considérait néanmoins que le comportement du salarié était suffisamment grave pour justifier son licenciement immédiat (on est en droit de considérer tout de même que les propos tenus par l’impétrant allaient un peu au-delà du sexisme).
Rappelons ici que le harcèlement sexuel est jugé de manière constante comme constitutif d’une faute grave (Cass. soc. 24-10-2012 no 11-20.085 F-D).
C’est d’autant plus étonnant de n’avoir pas retenu cette qualification que le salarié était coutumier du fait, comme rappelé dans le corps de la missive de rupture : deux ans plus tôt, l’intéressé avait baissé ses sous-vêtements pour faire mine de montrer ses parties génitales à la même collègue (décidément privilégiée) ou bien avait traité de « gouine » une autre collègue qui s’était refusée à lui.
Pourtant la Cour d’appel, sans nier la matérialité des faits reprochés, écarte la faute grave et juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au motif que l’intéressé justifie de deux circonstances atténuantes : il a près de sept ans d’ancienneté et ne présente aucun antécédent disciplinaire.
Ce raisonnement n’est heureusement pas suivi par la Cour de cassation, qui censure la décision des juges du fond pour violation de la loi, en rappelant que le fait d’adopter un comportement sexiste et de tenir des propos dégradants à l’encontre d’une collègue est constitutif d’une faute grave.
Terminons par une illustration gastronomique du même raisonnement : la Cour d’appel de Paris a considéré justifié le licenciement d’un supérieur hiérarchique qui faisait régulièrement des allusions sexuelles à ses collègues, notamment en offrant des pâtes en forme… de pénis (CA Paris 29 mars 2018, n° 16/02751).
Sébastien Bourdon