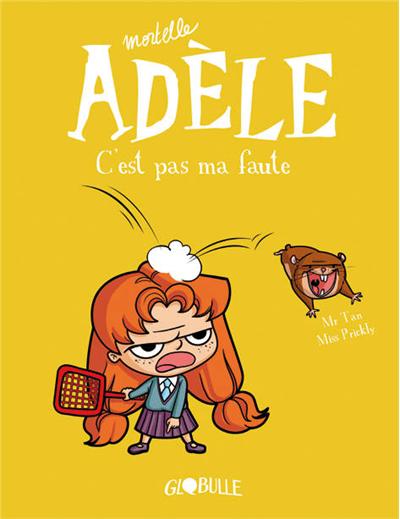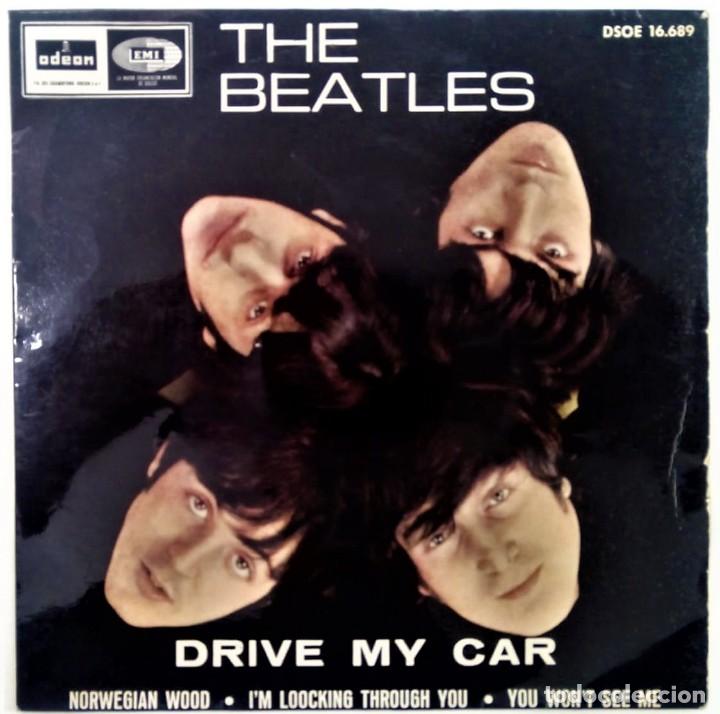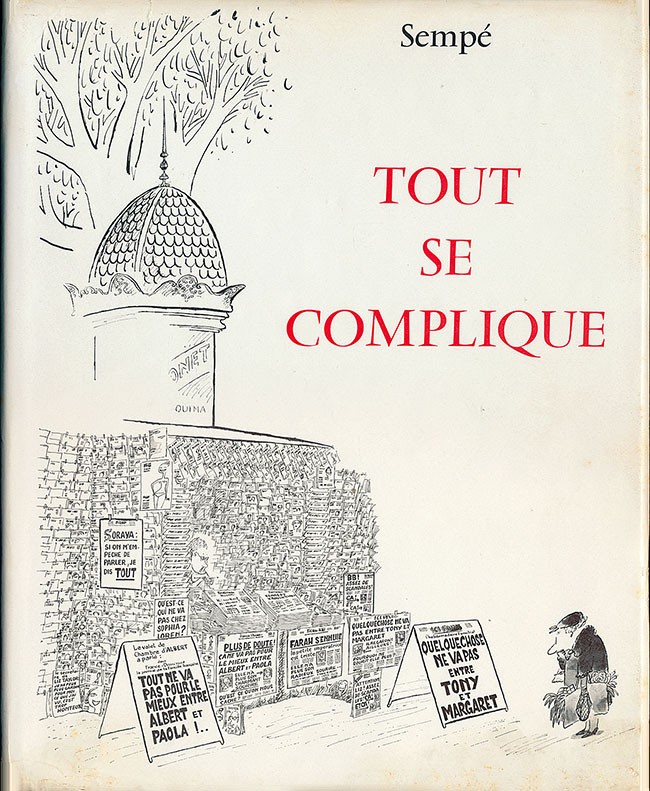Il y avait quelque chose d’absurde au royaume du droit social à imaginer que soient compatibles les notions de forfait jours et de travail à temps partiel.
Pour mémoire, la convention de forfait jours permet de sortir certains salariés du décompte normal du temps de travail et de mesurer leur durée de travail annuelle par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées sur ladite période.
La nécessaire convention ou l’indispensable accord collectif fixant les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours détermine au passage le nombre de jours travaillés dans la limite maximale de 218 jours.
Dans l’espèce qui nous agite, un salarié ayant conclu avec son employeur une convention de forfait annuel de 131 jours avait saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein (et un rappel de salaire à ce titre). C’était bien tenté, mais en réalité, non.
Pour ce faire, il reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté la législation sur le travail à temps partiel, laquelle prévoit effectivement des mentions obligatoires dans le contrat de travail, en particulier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (article L 3123-6 du Code du travail).
Le lecteur avisé sent poindre le possible paradoxe : si l’on ne décompte effectivement pas le temps de travail, comment alors en coucher précisément sur le papier la répartition ?
La chambre sociale de la Cour de cassation éclaircit enfin le débat et affirme, à l’instar de la Cour d’appel initialement saisie, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent tout simplement pas être considérés comme des salariés à temps partiel (Cass. soc. 27-3-2019 n° 16-23.800 FS-PB, B. c/ Sté Giraudier conseil).
Comme évoqué supra, l’accord collectif autorisant la conclusion de conventions de forfait en jours fixe le nombre de jours de travail inclus dans ledit forfait, fixant ainsi un plafond (article L 3121-64 alinéa 3 du Code du travail). Ce principe n’interdit nullement ensuite aux parties de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à celui prévu par les partenaires sociaux.
Mais pour autant, cette durée de travail réduite et décomptée en jours ne se transforme pas en un temps partiel.
En effet, à quoi reconnaît-on un travailleur à temps partiel ? C’est celui dont le temps de travail est défini par référence au nombre d’heures de travail accomplies (et non pas au nombre de jours travaillés, c’est un peu sioux, mais finalement assez logique).
Ainsi, le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (article L 3123-6 du Code du travail).
Au contraire, le forfait en jours permet de s’extraire du décompte légal en heures. Le salarié qui y est soumis s’engage à travailler un certain nombre de jours par an, en partant du principe que le nombre réel d’heures effectuées est impossible à comptabiliser.
Cette incompatibilité méritait d’être soulignée, la Cour s’en est enfin chargée.
Sébastien Bourdon