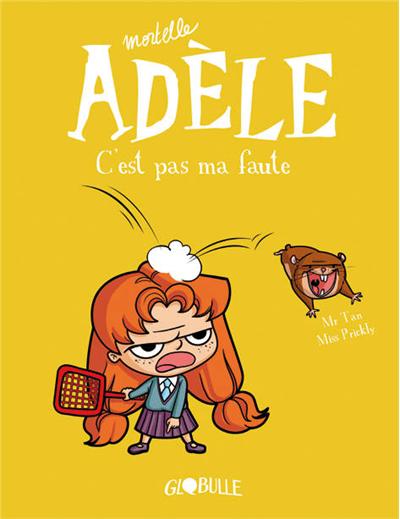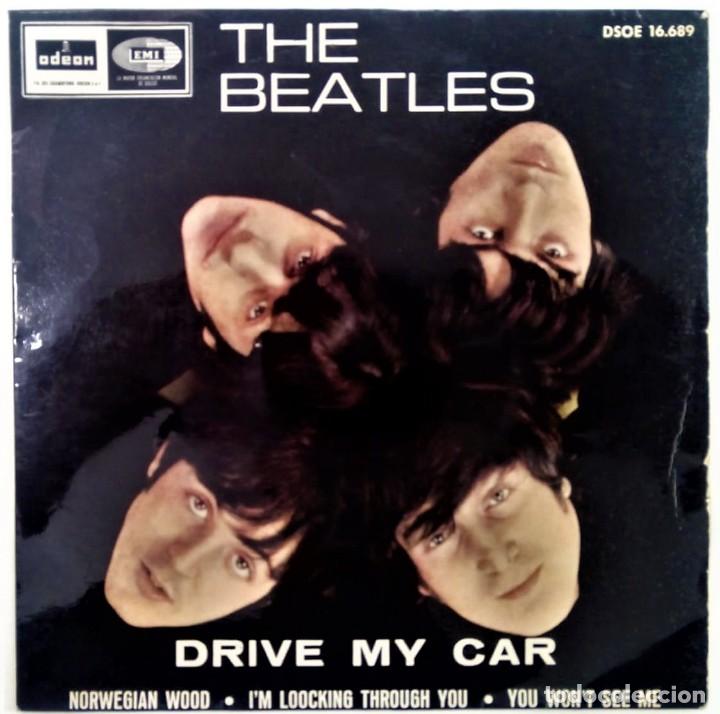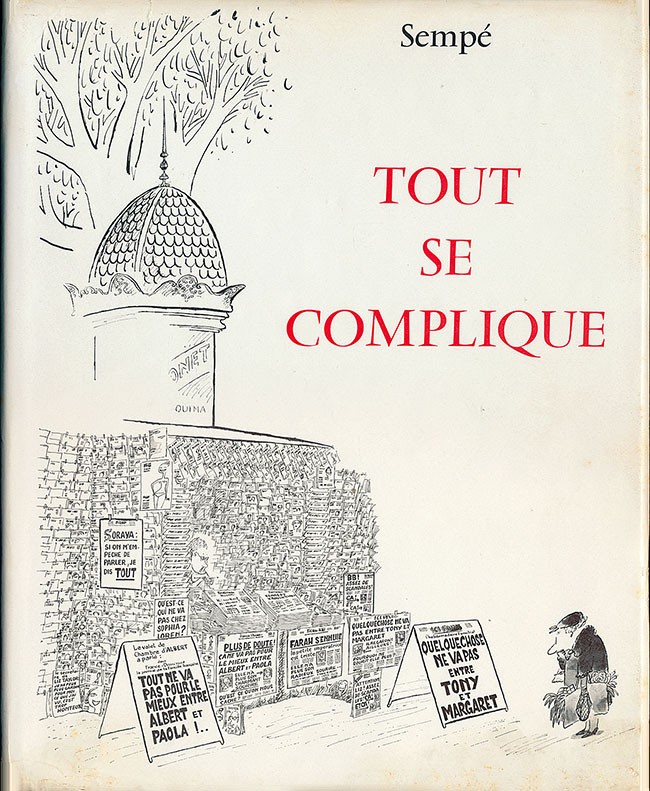Alors que la Cour de cassation tranchera très prochainement (le 17 juillet) la demande d’avis dont elle a été saisie notamment par le conseil de prud’hommes de Louviers et portant sur la conformité du barème « Macron » avec les articles 24 de la charte sociale européenne et 10 de la convention 158 de l’OIT, le débat continue à faire rage, chaque juridiction prud’homale ayant son avis sur la question, et pas forcément le même (sinon ce n’est pas drôle).
Ainsi, alors que le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire juge le barème conforme aux textes internationaux (Cons. prud’h Saint-Nazaire 24-6-2019 n° 18/00105), celui de Longjumeau admet qu’il peut ne pas être appliqué lorsque le salarié apporte la preuve que le montant réel de son préjudice excède les plafonds qui y sont prévus (Cons. prud’h Longjumeau 14-6-2019 n° 18/00391).
Dans les deux cas les demandeurs soutenaient évidemment que le barème devait être écarté, ce que les juges prud’homaux ont donc entendu différemment.
Comme avant lui les conseils de prud’hommes du Mans (https://bourdonavocats.fr/blog/bourdonnement.asp?id=55) et de Caen (Cons. prud’h. Caen 18-12-2018 no 17/00193 : RJS 3/19 no 155), notamment, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire déclare que les dispositions de l’article L 1253-3 du Code du travail prévoyant le barème d’indemnités ne sont pas contraires à celles de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. Il ne se prononce pas sur leur conformité à l’article 24 de la charte sociale européenne estimant que ce texte n’est pas directement applicable par la juridiction prud’homale, tout en soulignant qu’il comporte un principe similaire aux dispositions de l’article 10 de ladite convention.
Les juges estiment « que l’indemnité prévue au barème a vocation à réparer le préjudice résultant de la seule perte partielle injustifiée de l’emploi et que, si l’évaluation des dommages et intérêts est encadrée entre un minimum et un maximum, il appartient toujours aux juges, dans les bornes du barème ainsi fixé, de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié lorsqu’il se prononce sur le montant de l’indemnité ».
Et d’ajouter « que les autres préjudices, en lien avec le licenciement et notamment les circonstances dans lesquelles il a été prononcé, sont susceptibles d’une réparation distincte sur le fondement du droit à responsabilité civile, dès lors que le salarié est en mesure de démontrer l’existence d’un préjudice distinct ».
Mais à Longjumeau, on fait résonner un tout autre son de cloche.
Dans sa décision, la formation de départage de ladite juridiction prévient qu’elle ne se sentira pas très liée par ce qu’ont pu dire ou penser la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat : elle affirme ainsi que la question de la conformité du barème aux textes internationaux ne relève pas de la procédure d’avis devant la Cour de cassation, se référant à un avis rendu en ce sens le 12 juillet 2007 (Avis Cass. soc. 12-7-2017 no 17-70.009 PB). Par ailleurs, la même formation estime ne pas être tenue par la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018, dans la mesure où le contrôle de conventionnalité d’un texte ne relève pas de celui-ci, ni par celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2017 puisque « l’interprétation d’une disposition par le Conseil d’Etat ne s’impose pas aux juridictions de l’ordre judiciaire, en application du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ».
Les mains ainsi totalement libérées, le conseil de prud’hommes reconnaît un effet horizontal tant à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT qu’à l’article 24 de la charte sociale européenne, de sorte qu’ils peuvent être invoqués par le salarié devant le juge du travail dans une instance l’opposant à son employeur.
Cela fait, les juges s’attaquent aux dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail et affirment qu’elles pourraient avoir un effet contraire aux dispositions des textes internationaux précités lorsqu’un salarié ne relevant pas d’une exception prévue par l’article L 1235-3-1 (écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement) « est en mesure de démontrer que le montant réel de son préjudice matériel excède le plafond prévu par le barème légal d’indemnisation et lorsque ces dispositions ne permettent donc pas une réparation intégrale du préjudice matériel subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Pour la faire brève, le barème s’applique… sauf s’il ne doit pas s’appliquer. Si ses dispositions sont insuffisantes à indemniser le préjudice établi, il suffit donc de ne pas en tenir compte. Le barème devient tout simplement facultatif.
Avec de telles décisions contradictoires et libérées, vivement la suite !!.
Sébastien Bourdon