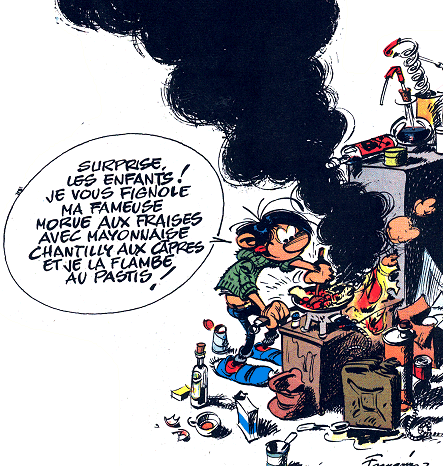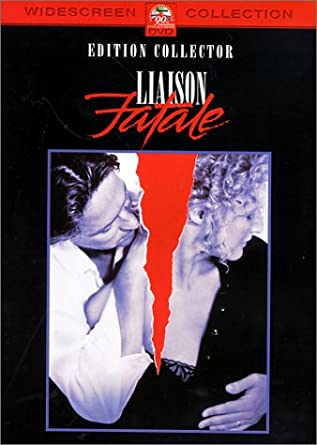Quel avocat ne s’est entendu dire, à peine son tour venu et sur le point de commencer sa plaidoirie, « Maître, je vous en prie, soyez bref » (un avocat célèbre aurait un jour répondu : « Monsieur le Président, si ce métier ne vous plaît pas, vous n’avez qu’à en choisir un autre »).
Ce qui nous est maintenant demandé instamment à l’oral serait en passe de l’être également à l’écrit. En effet, dans une note du 27 août 2021, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS) propose là d’encadrer davantage les écritures des avocats, notamment en imposant un résumé de taille limitée.
Pour les béotiens, précisons tout de suite ce qu’est la DACS, organisme ancestral puisque créé au début du 19ème siècle : elle a notamment pour mission d’élaborer ou concourir à la rédaction des lois et réglementations en matière civile et commerciale (un « comité Théodule » comme aurait dit le Général ?).
Et voilà que cette Direction, dans la notoire torpeur estivale du mois d’août, a pondu une note modestement intitulée « Structuration des écritures des avocats et dossier unique de pièces : propositions ». Or, ce qu’elle propose revient à enfermer plus encore la profession d’avocat et la défense de manière générale dans un cadre réglementaire dont on nous permettra de dire qu’il est insupportable. On ne cesse de vouloir réduire notre temps de parole, voilà qu’on veut raccourcir notre propos (rappelons qu’il ne s’agit pas là de défendre une profession mais de rappeler que justement, il s’agit de défendre le citoyen).
En effet, il est préconisé de modifier les articles 768 et 954 du Code de procédure civile, pour prévoir en première instance comme en appel :
- « une nouvelle synthèse des moyens obligatoire en fin de discussion,
- la limitation de la taille de celle-ci à 1000 mots,
- L’obligation de récapituler les moyens dans l’ordre des prétentions et sous la forme d’une liste numérotée, comprenant mention des pièces afférentes,
- la création d’un dossier unique de pièces inspiré de la pratique administrative ».
Et de préciser que le tribunal ne sera « valablement saisi que des moyens développés dans la discussion et récapitulés dans la synthèse ».
Evidemment, et selon une technique de communication devenue la norme en matière d’annonces gouvernementales, on nous précise que ce ne serait là que piste de réflexion (bien glissante la piste quand même).
Ces précautions langagières n’ont pas suffi à éviter la prévisible explosion de colère des avocats devant ce qui ne peut être vu que comme une atteinte à l’indépendance de l’avocat et une tentative de bafouer les droits de la défense même.
La Conférence des bâtonniers a évidemment immédiatement condamné une telle idée de réforme – « Les conclusions en 1 000 mots, c’est 1 000 fois non » – y voyant une « limitation inacceptable des droits des parties ».
Quant à limiter le nombre de mots, au-delà du « Fahrenheit 451 » annoncé de nos écritures, comment ne pas penser aux risques d’omission, de responsabilité professionnelle etc. ? « Ah oui, Monsieur Lupin, j’ai pas mis l’article machin, mais j’avais atteint le maximum de mots et il n’y avait plus de place dans le formulaire… »
On ne peut que s’étonner de cet enthousiasme étatique à fragiliser l’existant plutôt que d’annoncer de réelles et nécessaires réformes au fonctionnement d’une justice souvent appauvrie et sinistrée. Il en est ainsi de la complexité grandissante des procédures, véritable repoussoir au justiciable qui préférera jeter l’éponge que de se défendre dans un tel labyrinthe procédural.
Si l’on résume, moins à écouter, moins à lire, voilà qui annonce peut-être une réduction du nombre de magistrats à qui l’on expliquera bientôt qu’ils sont trop nombreux au regard de la réduction exponentielle de leurs tâches. La réduction de personnel est d’autant plus annoncée que l’on parle maintenant d’algorithmes à même de décortiquer les décisions précédemment rendues pour permettre aux magistrats de rendre les leurs (DataJust).
Sébastien Bourdon