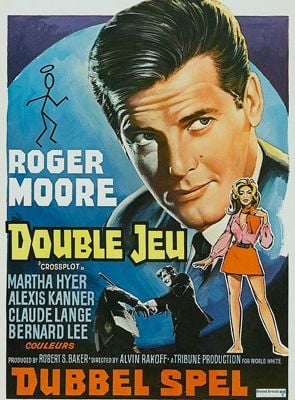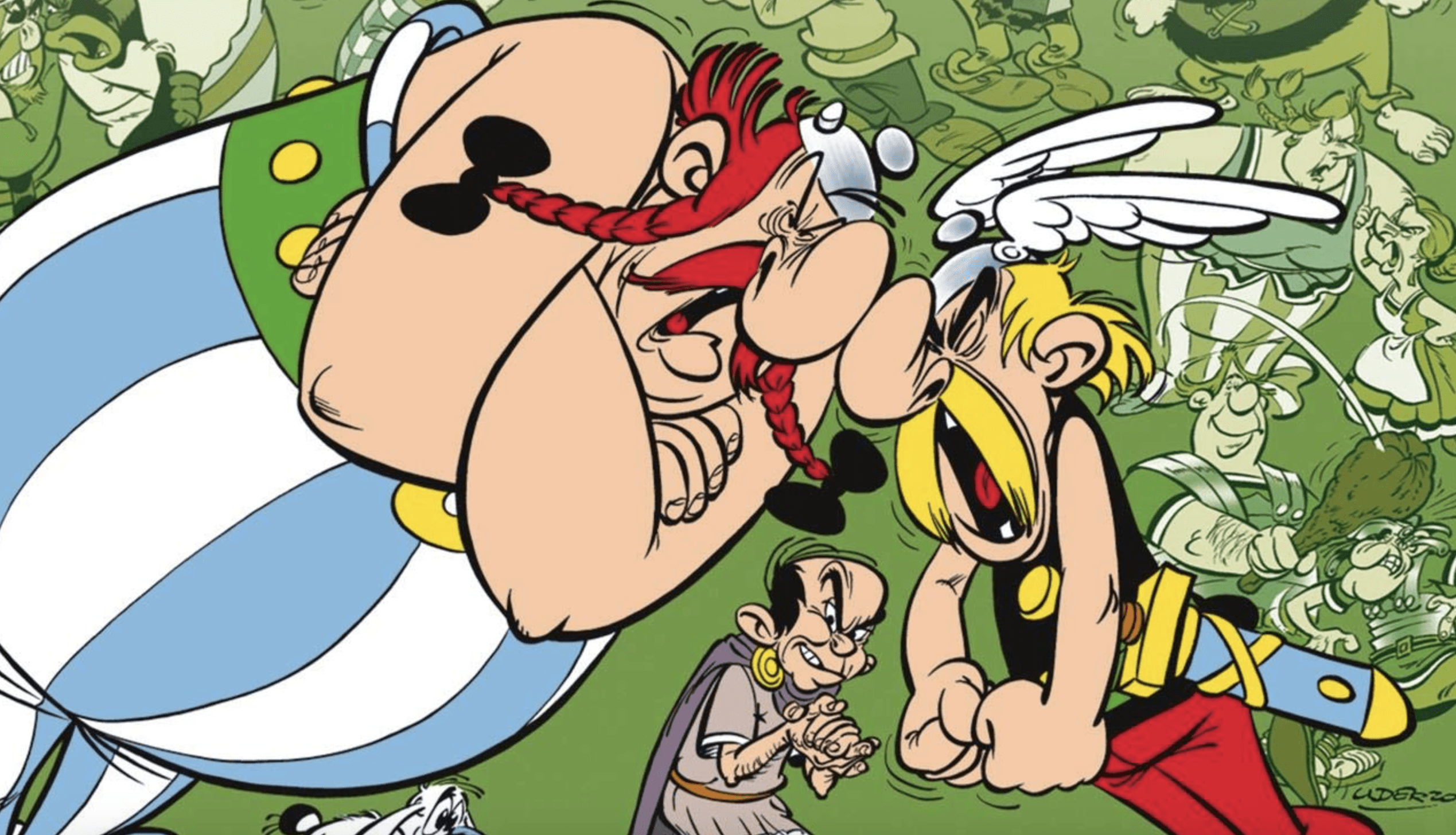La curiosité peut pour l’employeur être un vilain défaut, quand bien même elle lui semblerait légitime.
Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation a ainsi considéré que l’employeur n’avait pas de droit de regard sur la situation familiale de ses salariés (Cass. soc. 10-12-2025 no 24-17.316 FS-B, I. c/ Sté Chanel).
Il faut dire que cette liaison avait tout pour déplaire, l’idylle s’étant nouée avec une ancienne salariée en litige avec l’entreprise, ce que l’employé épris s’était évidemment bien gardé de révéler.
La cour d’appel de Versailles avait d’abord jugé justifié le licenciement dudit salarié.
Au soutien de son argumentation, l’employeur invoquait, et ce n’était pas absurde, un manquement du salarié à son obligation de loyauté et un risque de conflit d’intérêts.
Il faut dire que le garçon avait quand même accès à du lourd en termes d’informations confidentielles, ayant des missions d’audit et de contrôle interne, étant, en application de la charte éthique, dans l’obligation d’informer son employeur de tout risque de conflit d’intérêt.
La société avait donc considéré cette dissimulation de lien matrimonial comme constitutive d’un doute légitime sur la loyauté du salarié.
Le salarié s’est pourvu en Cassation, avançant les trois arguments suivants :
. cette relation était dépourvue de tout rapport avec ses fonctions et insusceptible d’en affecter le bon exercice ;
· l’obligation d’information prévue par la charte éthique de l’entreprise ne portait que sur les « relations d’affaires effectives ou potentielles », la relation matrimoniale n’entrant alors pas dans ladite définition ;
· la suspicion que le salarié puisse communiquer des informations confidentielles à son épouse relève de la perte de confiance et ne peut justifier un licenciement.
Sur ce, la Cour de cassation a rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de sa vie privée, l’employeur ne pouvant alors pas l’obliger à lui communiquer des informations sur sa situation familiale.
La Cour ajoute qu’il aurait fallu démontrer que la situation matrimoniale pouvait influer sur les fonctions exercées, au détriment des intérêts de l’entreprise.
Or, l’existence d’un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l’entreprise, et l’employeur, ne suffisait pas à caractériser un conflit d’intérêt tel que défini par la charte applicable dans l’entreprise.
Il en résulte que le salarié pouvait tout à fait librement conserver par devers lui les informations afférentes à sa vie privée (souvenons-nous que s’agissant d’un DRH et d’une déléguée syndicale, la solution n’avait pas été la même).
Sébastien Bourdon
Crédit photo : « Vie Privée » de Louis Malle