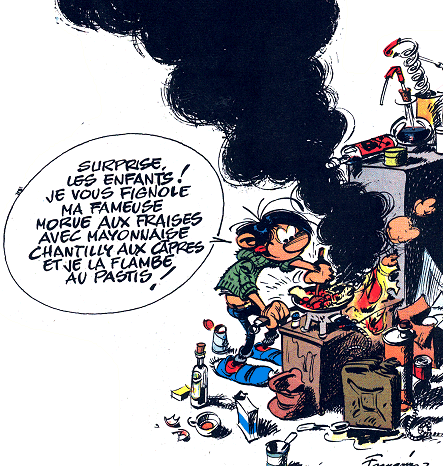La Cour de cassation a récemment rendu une décision discrète mais éclairante sur la prise en charge des frais afférents au télétravail.
Cette question étant pour le moins sous les feux de l’actualité récente, pandémie oblige, il était probablement pertinent de la décortiquer un peu (Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783 ; 19-13-855).
En l’espèce, et entre autres demandes, le salarié concerné avait sollicité de son employeur le remboursement de divers frais exposés par ses soins dans le cadre du télétravail. Sur le principe, on ne voit pas bien ce qui aurait bien pu justifier qu’on le lui refuse, à un détail près, et pas des moindres.
En effet, précurseur d’un mode d’organisation du travail devenu banal depuis le mois de mars 2020, cet employé avait décidé de lui-même de se mettre en télétravail, sans l’aval de son employeur.
Or, et pour mémoire, le télétravail peut être mis en place dans l’entreprise à deux conditions, non-cumulatives :
- dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE), s’il existe.
- en l’absence de charte ou d’accord collectif, le salarié et l’employeur doivent formaliser par tout moyen leur accord de recourir au télétravail.
Ainsi, alors qu’aucune de ces deux conditions n’était remplie, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin de se faire rembourser les frais exposés dans le cadre du travail effectué à son domicile.
Il invoque à cette fin les articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail, mettant à la charge de l’employeur tous les coûts découlant directement du télétravail, indépendamment de la question de savoir qui est à l’origine de la décision d’y recourir, dès lors qu’il est établi que la prestation assurée par le télétravailleur l’est au profit de l’employeur (l’abonnement NETFLIX n’est pas inclus dans ce package, faut-il le rappeler).
Cette analyse il est vrai discutable n’avait pas été retenue par la Cour d’appel, qui avait fait ressortir qu’il n’existait aucun accord entre le salarié et l’employeur sur le recours au télétravail. En considération de ces éléments, la Cour de cassation a logiquement confirmé que le salarié ne pouvait se prévaloir de la législation relative au télétravail et donc obtenir un quelconque remboursement.
C’est donc une situation très particulière qui est ici tranchée, celle d’un salarié qui, tout seul, décide un beau matin qu’il n’ira plus au bureau et qu’il travaillera de son canapé, aux frais de celui qui l’emploie. C’était faire peu de cas du lien de subordination, ce qui lui a été ici rappelé.
S’agissant des périodes de pandémie – on ne sait jamais, ça pourrait encore durer ou se reproduire – le législateur s’est plutôt penché sur la question de pouvoir l’imposer sans plus de façons au salarié. Ainsi, le risque épidémique peut justifier le recours au télétravail sans son accord et sa mise en œuvre dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier. L’employeur peut donc mettre en place le télétravail sans accord ou charte, et ne consulter le CSE – pour peu qu’il y en ait un – qu’après la mise en œuvre de sa décision, à condition de l’en informer sans délai.
Sébastien Bourdon
Illustration : sms de la compagne du rédacteur