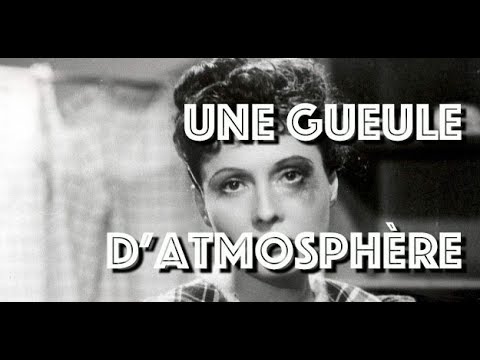Le harcèlement moral n’est pas seulement un échange toxique entre deux personnes, mais peut relever d’une politique d’entreprise, comme l’a récemment confirmé la Cour de cassation (Cass. crim. 21-1-2025 no 22-87.145 FS-B-R).
L’affaire est connue, s’agissant de France Telecom, dont les méthodes de management et leurs effets délétères ont largement défrayé la chronique.
En 2009, un syndicat porte plainte pour harcèlement moral contre l’entreprise et certains dirigeants pour avoir mis en œuvre un plan – à l’appellation sans ambiguïté – « NEXT » (« Nouvelle Expérience des Télécoms ») et son volet social, le programme « ACT » (« Anticipation et Compétences pour la Transformation »), avec pour ambition de réduire les effectifs à hauteur de 22 000 salariés sur un total d’environ 120 000.
Etaient poursuivis du délit de harcèlement moral le PDG, le Directeur des Opérations et certains exécutants des basses œuvres. Il leur était notamment reproché d’avoir dégradé les conditions de travail de 39 salariés par des agissements répétés de harcèlement, créant un climat professionnel anxiogène.
Tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel de Paris ont jugé que certains prévenus s’étaient rendus coupables de harcèlement moral institutionnel ou de complicité de ce délit.
Rappelant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et affirmant que le harcèlement moral institutionnel n’existait pas car n’entrant pas la définition de l’article 222-33-2 du Code pénal, les prévenus forment un pourvoi.
Selon eux, le harcèlement moral ne peut être caractérisé qu’en présence de relations interpersonnelles entre l’auteur des agissements incriminés et une ou plusieurs personnes déterminées. Une politique dite d’entreprise ne pourrait être sanctionnée.
La Cour de cassation a fait son boulot de juriste – c’est bien le moins – et recherché quel était le sens donné par le législateur à l’article 222-33-2 du Code pénal au moment de son adoption le 17 janvier 2002.
Après quelques recherches exégétiques, elle conclut que le législateur avait souhaité adopter une définition « la plus large et la plus consensuelle possible » de cette incrimination.
Elle confirme donc les condamnations, considérant que l’élément légal de l’infraction de harcèlement moral n’exige pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles entre leur auteur et la ou les victimes. Il suffit de faire partie de la même communauté de travail et d’avoir subi les désagréments du harcèlement moral tels que définis par le Code pénal.
A partir du moment où a été mise en place une politique d’entreprise visant à nuire à la collectivité de travail afin de la réduire drastiquement – ce qui a été établi en l’espèce – cette atteinte aux droits et à la dignité des salariés pouvait caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel entrant dans la définition de l’article 222-33-2 du Code pénal.
Sébastien Bourdon